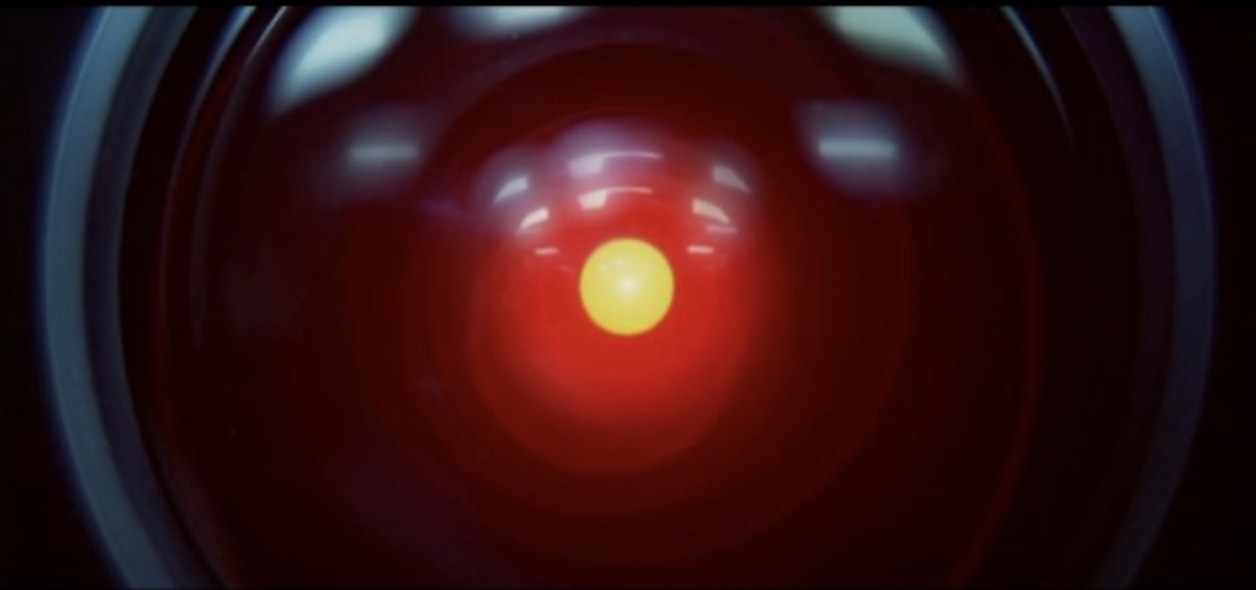La crise de la bande dessinée et sa spécificité
Les Etats généraux ont été créés en octobre 2014 lors du festival Quai des bulles de Saint-Malo. La réforme des retraites a été l’élément déclencheur mais le contexte général justifie amplement à lui seul le lancement d’un vaste chantier de réflexion. En effet, comme l’a rappelé Benoît Peeters (qui préside l’association porteuse des États Généraux et qui animait la séance inaugurale à Angoulême), « oui, la bande dessinée se porte plutôt bien artistiquement ; non, la bande dessinée ne se porte pas si bien que ça sur le terrain économique. »
Dans une certaine mesure, la crise que traverse la bande dessinée comporte des éléments communs avec l’ensemble du monde du livre, comme la surproduction ou le développement du numérique et des problématiques qui y sont liées. Mais il y a également une singularité de la bande dessinée. Historiquement, le milieu dans lequel la bd s’est développée est celui de la presse et des journaux spécialisés. Ces supports ont presque tous disparus aujourd’hui au profit de l’album ou du roman graphique. En intégrant progressivement le monde du livre, les auteurs de bd ont certes bénéficié d’une reconnaissance symbolique accrue mais, en contrepartie, leur situation économique s’est fragilisée en s’alignant sur celle des écrivains. Dans le documentaire Sous les bulles de Maïana Bidegain, Jean-Louis Boquet résume la situation de la façon suivante :
Les auteurs des années 70 étaient payés à la page, ce qui était normal : on remplit un journal, on paie à la page […] Dans les années 2000, les auteurs de bande dessinée se retrouvent dans le même système économique que la littérature : tu fais un livre, tu es payé pour ce livre, tu es payé non pas en fonction de ton temps de travail […] tu es payé en fonction de ta valeur sur le marché. ((J’ai rédigé un compte-rendu détaillé de ce documentaire, qui est consultable ici))
Cet alignement sur l’univers de l’écrit est non seulement une source de précarité mais il rend également de plus en plus difficile l’exercice du métier : à l’inverse d’un romancier, d’un journaliste ou d’un essayiste, un auteur de bd n’est pas seulement un intellectuel, c’est également un artisan qui a besoin d’un atelier pour travailler et d’énormément de temps pour s’impliquer dans des projets de longue haleine. La bande dessinée peut difficilement s’envisager comme une activité en pointillé, comme un passe-temps en dehors des heures de bureau ou comme le prolongement d’une activité universitaire. Les choses deviennent encore plus complexes lorsqu’on se penche sur certains métiers spécialisés, comme celui de coloriste, coincé entre le statut de l’imprimeur et celui de l‘auteur. Il a toujours été difficile pour un dessinateur de vivre de son art mais un palier supplémentaire semble désormais atteint. Comme le souligne Xavier Guilbert dans sa Numérologie 2014, ce sont désormais des auteurs « chevronnés » qui sont contraints de jeter l’éponge : « Bruno Maïorana (dessinateur de la série Garulfo chez Delcourt) et le scénariste Philippe Bonifay, ont annoncé mettre un terme à leur carrière dans la bande dessinée en mai 2014. »
De bonnes questions et de mauvaises réponses ?
Le premier objectif des États Généraux est de produire une photographie du monde de la bande dessinée qui est encore très mal documenté. Cet état des lieux se déclinera en deux versants. Le premier relève plutôt de la revendication sectorielle, avec des « cahiers de doléances » qui seront remplis « par branche professionnelle, par localisation, par activité, lors de festivals ou par les organisations représentatives. » Le second chantier appartient davantage au registre universitaire, avec une vaste enquête scientifique à laquelle contribueront plusieurs spécialistes de la sociologie de la culture (Pascal Ory, Nathalie Heinich, Bernard Lahire…) ou de la bande dessinée (Thierry Groensteen, Jean-Pierre Mercier).
Sur un plan plus concret, certaines pistes de réforme ont été ébauchées. Malheureusement, la plupart de ces idées sont calquées sur les positions les plus réactionnaires du syndicat de l’édition. Benoît Peeters a commencé par agiter comme un chiffon rouge le récent rapport Reda :
A la Commission et au Parlement européen, le principe même du droit d’auteur est remis en cause. Un rapport a été commandé à une députée du Parti Pirate, ce qui est tout un symbole. Le travail acharné des lobbies cherche à imposer l’idée que le droit d’auteur est un obstacle à la création, à la circulation des œuvres et des idées.
Il peut être utile de rappeler ici que, dans son rapport, l’eurodéputée Julia Reda plaide bien pour une réforme (somme toute modeste) du droit d’auteur (harmonisation des durées de protection à l’échelle communautaire, renforcement des exceptions pour l’éducation et la recherche, interdiction des entorses au domaine public, droit de prêt numérique…) mais tout en affirmant que « le cadre juridique européen sur le droit d’auteur et les droits voisins est central pour la promotion de la créativité et de l’innovation. »
Peeters a ensuite plaidé pour « une sorte de droit de suite sur le marché du livre d’occasion », en quoi il a été soutenu par Vincent Monadé du CNL :
Lorsque Jeff Koons expose des chiens en ballon à Pompidou alors qu’il a déjà vendu l’œuvre, il est payé, il y a un droit de suite. Lorsque Jacques Tardi vend plusieurs fois sur des marketplaces Adèle et la bête, il n’y a pas de droit de suite. Autrefois, ce n’était pas gênant parce que l’occasion était limitée à des boutiques qu’on connaissait (Boulinier, Gibert…). Aujourd’hui sur Internet il y a énormément de gens qui font de l’argent avec l’occasion.
Présenter les choses de cette manière, en opposant benoîtement Jacques Tardi et Jeff Koons, prête à confusion. Le droit de suite correspond en effet à la part financière qui revient à un créateur lors de la revente d’une de ses œuvres sur le marché de l’art. Lorsque Tardi vend une planche dans une vente aux enchères, il touche bien un droit de suite comme n’importe quel plasticien, mais ce n’est évidemment pas le cas pour ses albums qui sont des livres et pas des œuvres originales. Le droit de suite et la taxation des livres d’occasion correspondent à des démarches différentes, à des logiques différentes, et le rapprochement des deux est tout sauf évident, contrairement à ce que laisse entendre Vincent Monadé.
La dernière idée forte sur laquelle Benoît Peeters a conclu son discours est celle d’un domaine public payant basé sur « la belle idée de Victor Hugo » : « une petite redevance sur les œuvres du domaine public servant à protéger les auteurs des nouvelles générations. » Lionel Maurel a consacré un long billet de blog a l’idée de domaine public payant. Il suffit ici de rappeler que cette idée, lourde de conséquences, revient à supprimer la liberté de puiser dans les œuvres du passé pour les adapter, les rééditer et les réinventer. Est-ce vraiment une bonne idée à l’heure où le patrimoine numérisé devient enfin accessible à tous, et alors que se développent toutes sortes de pratiques artistiques basées sur la transformation, la citation ou le remix ?… D’autre part, la position de Victor Hugo dont on invoque le nom comme un totem est bien plus nuancée que celle qu’on lui prête puisque chez lui, comme le rappelle Lionel Maurel, la contrepartie du « domaine public payant » est un « domaine public immédiat » basé sur la « distinction entre les droits de l’auteur de son vivant et ceux qui appartiendront ensuite à ses descendants après sa disparition » : « Son idée est que les droits des héritiers doivent être réduits à un droit à toucher une redevance pour l’exploitation de l’œuvre, mais qu’ils ne devraient pas pouvoir exercer un contrôle sur l’œuvre, que n’importe quel éditeur devrait pouvoir exploiter sans autorisation. Hugo demande donc pour les héritiers la transformation du droit exclusif en un simple droit à une rémunération. »
Un front divisé
Comme souvent dans le monde de la bande dessinée, la véritable bouffée d’air frais est venue des éditeurs indépendants : Jean-Louis Gauthey a annoncé officiellement la création d’un Syndicat des Editeurs Alternatifs (SEA) regroupant une vingtaine de maisons (comme Cornélius, FLBLB, Çà et Là…) et visant à faire contrepoids au discours du groupe bd du SNE affublé du sobriquet de « BEDEF » (par analogie avec le MEDEF) :
Les éditeurs qui constituent le SEA ont des divergences de pratique, de point de vue, voire même de philosophie avec des éditeurs dont la vocation est par nature plus industrielle […] Le SEA ne croit pas, contrairement à une récente ministre de la culture, que l’édition c’est avant tout les éditeurs. L’édition c’est avant tout les auteurs.
La première initiative du SEA va être la création d’un nouveau modèle de contrat-type « qui tiendra sur une feuille A4 recto verso » et qui n’enchainera plus l’auteur à l’éditeur « pour la durée de la propriété intellectuelle […] c’est à dire pour sa vie entière. »
Les interlocuteurs qui se sont succédé sur la scène du théâtre d’Angoulême le 30 janvier étaient nombreux : une vingtaine d’institutions et d’associations professionnelles étaient représentées. Comme on pouvait s’y attendre, l’intervention du représentant du RAAP (Régime des artistes et auteurs professionnels) a donné lieu à des échanges agressifs, mais d’autres lignes de fractures étaient également perceptibles : entre les auteurs de bd et les autres auteurs (écrivains mais aussi illustrateurs), entre les petits et les gros éditeurs, et entre les lecteurs et toute l’interprofession. Malgré la présence de la Bibliothèque nationale de France, les lecteurs n’étaient en effet représentés par aucune instance (« j’espère qu’on n’en a pas invités » a ironisé Jean-Louis Gauthey).
Sous l’apparence d’un front commun, cette session d’ouverture des États Généraux de la bande dessinée était traversée par les mêmes fissures qui touchent aujourd’hui le monde de l’édition et peut-être même le champ de la culture tout entier.